« La perte sera tout, la douleur et la joie » (Robert Davreu).
Les 28 et 30 juin 2015, à l’occasion de « Mons 2015 – Capitale européenne de la culture », Wajdi Mouawad a porté à la scène par deux fois l’ensemble des sept tragédies de Sophocle, sous le titre Le dernier jour de sa vie. Il reprenait, les concentrant en une journée-fleuve, trois spectacles qu’il avait consacrés au poète, autour de trois thèmes : Des femmes, créé en 2011, et qui enchaînait Les Trachiniennes, Antigone et Électre ; Des héros, créé en 2014, mise en scène de l’Œdipe Roi et d’une adaptation d’Ajax, Ajax-un cabaret ; enfin, Des mourants, une création de W. Mouawad inspirée de Philoctète et d’Œdipe à Colone.
Wajdi Mouawad présente la genèse du Dernier jour de sa vie dans le livret du spectacle et à l’ouverture de celui-ci. Après la création du Sang des promesses, dont on connaît souvent, notamment, le tome 2, Incendies, l’artiste a souhaité se tourner vers d’autres dramaturges pour, selon ses mots, « en faire un énorme atelier d’écriture, véritable espace de confrontation à un auteur à travers le corps des acteurs ». Cette aventure, il la conçoit comme une aventure collective, que ce soit avec son équipe, avec laquelle il souhaite se confronter à « un travail impossible. Une dinguerie. Une démesure », et avec son public, en visant une « catharsis collective ». Il choisit Sophocle, dont la découverte, en 1991, l’a profondément marqué, et qui pour lui, représenterait le mieux la réalité d’un monde aussi bien classique que contemporain, dans lequel, « indifférents, les Dieux s’évanouissent et les héros chutent ».
Pour établir la médiation entre le texte de Sophocle et nous, W. Mouawad s’adresse au poète Robert Davreu : ce dernier traduit l’ensemble des pièces du cycle Des femmes ainsi qu’Œdipe Roi. Mais il disparaît en 2013. Ainsi, si les quatre premières pièces du spectacle sont bien, directement, celles de Sophocle traduites par Davreu1, les trois suivantes (Ajax-un cabaret ; Inflammation du verbe vivre, issue de Philoctète ; et Les Larmes d’Œdipe, issue d’Œdipe à Colone) sont basées sur des textes de W. Mouawad inspirés de Sophocle. Le dramaturge est venu s’en expliquer au public au début de chacune des deux journées du 28 et du 30 juin : continuer après Œdipe Roi sans Robert Davreu aurait été trahir ce dernier − auquel l’ensemble du spectacle est d’ailleurs dédié −, Sophocle, et le projet. Ainsi, la deuxième partie du spectacle, si elle forme une unité avec la première, par sa référence au poète tragique et ses thèmes majeurs d’inspiration, est sensiblement différente. L’ensemble forme ce que W. Mouawad décrit comme « une sorte de sédimentation d’une compréhension et une appropriation personnelles de l’œuvre de Sophocle ».
Aller voir ce spectacle représente une aventure en soi, ne serait-ce que par ses conditions matérielles. On n’est peut-être pas très éloigné de l’expérience que faisait le spectateur du Ve s. av. J.-C. : déplacement et investissement complets dans la fête, puisqu’il s’agit d’aller vivre à Mons plusieurs jours ; début de la représentation à l’aube et même dans le noir, à 5h30, pour une folle journée qui se terminera à presque 1h du matin ; temps convivial, puisque les sept spectacles sont entrecoupés de pauses et de restaurations, qui permettent d’échanger, mais aussi de se rencontrer, entre simples citoyens, et avec les notables, comme au théâtre de Dionysos − la maire de Lille, Martine Aubry, était ainsi du public le dimanche 28 juin − ; journée chaude, sans doute plus chaude qu’aux Grandes Dionysies d’Athènes qui se déroulaient à la fin du mois de mars, puisqu’il faut regretter que le théâtre du Manège n’ait pas disposé de climatisation, ni même d’aération, à cette époque de l’année, et avec ses cinq cents spectateurs présents toute la journée.
Ces conditions forment un tout avec l’expérience de la représentation des sept tragédies, véritables créations au sens le plus noble du terme. Les quatre premières pièces, dont je vais parler ici et qui sont donc fondées sur la traduction des tragédies de Sophocle par Robert Davreu, nous ont en particulier permis de mesurer à quel point, pour W. Mouawad, chaque représentation est une interprétation, un engagement par l’espace dans le sens, et une expérimentation, une exploration des possibilités de sens que donne la mise en scène dans toutes ses dimensions. Dans chaque cas, le dramaturge a adopté une approche radicalement différente, et le spectacle, malgré sa durée, n’est ainsi aucunement répétitif.
Les Trachiniennes
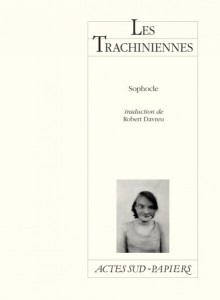
Les Trachiniennes sont précédées d’une présentation dynamique par W. Mouawad − qui se comporte alors autant en metteur en scène qu’en comédien − de la troupe, du spectacle et des poèmes, mais aussi du rôle attendu du public, ainsi lui-même mis en scène. Cette ouverture évoque le proagôn des festivals antiques, dans lequel on faisait défiler le personnel de la tragédie, avant sa représentation elle-même. Elle crée une interaction en même temps qu’une distance assumée avec les spectateurs : ils sont invités à se laisser dormir s’ils sont fatigués du spectacle ; ils sont rassurés, si d’aventure ils n’y comprennent pas tout.
La première pièce s’enchaîne naturellement. Quelques choix majeurs la marquent : Héraclès n’apparaît pas sur scène, mais son rôle est reporté sur Déjanire, qui devient elle-même une figure héroïque, qualifiée par ses exploits et ses épreuves ; cette réduction du nombre des personnages laisse ainsi mieux apparaître l’articulation fondamentale de la trame sur les récits, et en particulier ces passages typiques que sont les récits de messagers, qui ici, portent véritablement la tragédie. En témoigne la disposition des acteurs et du chœur, face au public, avec un micro, pour délivrer leurs « numéros » : le spectaculaire est ainsi assumé en tant que tel, comme porteur de la tragédie, dans un lien souligné avec les spectateurs (dont certains sont à un moment invités à monter sur scène). Le rôle de la musique est prépondérant : pour l’ensemble Des femmes, W. Mouawad a fait appel aux compositions originales de plusieurs artistes, Bernard Falaise, Pascal Humbert, Alexander Mac Sween et, enfin, Bertrand Cantat. Ce « chœur » impose sa force tout au long de la trilogie, et en particulier, même s’il n’est pas particulièrement mis en valeur, B. Cantat, dont la présence marquante, troublante pour des pièces qui évoquent des violences endurées par les femmes, contestée pour cela, semble pourtant avoir été pensée et assumée.
Antigone

Sur fond de bombardements, qui évoquent une guerre contemporaine, s’ouvre ensuite Antigone. Outre, là encore, la présence déterminante des chants, plusieurs choix peuvent être soulignés, qui n’épuisent pas la richesse de la représentation. La dimension comique que prend parfois le dialogue (par exemple avec la couardise du garde, qui redoute la colère de Créon), plus ou moins assumée dans les représentations de la pièce, n’est ici pas contournée, bien au contraire. Polynice et le garde sont incarnés par le même acteur, ce qui permet de mieux traduire physiquement l’enfermement d’Antigone dans le principe de son amour fraternel. Cet enfermement des personnages est également symbolisé par leur enroulement dans des voiles, qu’ils peuvent à l’occasion dérouler. Autre choix, celui de faire représenter Ismène par une actrice enceinte, qui est ainsi mieux à même d’incarner la continuité des liens de sang, qu’Antigone elle, paradoxalement, vient à rompre. Le paradoxe en général, voire la contradiction interne aux personnages ou du moins la limite de leurs discours, semblent soulignés par W. Mouawad, et deviennent un fil rouge dans leur représentation, jusqu’à faire d’eux les proies d’un délire : cela est particulièrement net dans le cas de Créon, dont la gestuelle semble vider et mettre à distance des arguments politiques qui semblent de plus en plus faibles. Antigone elle-même n’est pas épargnée, puisque son amour fraternel est exposé graduellement dans sa dimension la plus passionnelle : avec la mise en scène, avec les gestes qu’elle fait pour embrasser le cadavre de Polynice ; ou avec les choix de texte, puisque son affirmation qu’un enfant ou un père est remplaçable, mais non un frère, affirmation qui a pu choquer la critique au point qu’elle supprime parfois ces vers, est ici gardée.
Électre
 La matinée se terminait sur l’Électre, dernière tragédie des femmes. Les partisans de la fille d’Agamemnon, et qui soutiendraient sa vengeance, sont ici exposés à souffrir : dès le début de la tragédie, c’est la démence qui caractérise Électre, une démence violente, qui marque la représentation au point de la rendre particulièrement éprouvante. C’est peut-être dans cette perspective aussi, et afin de donner l’image d’une dissociation, que W. Mouawad a choisi, dans la parodos, de faire interpréter par la même actrice − celle qui représentait la douce Ismène dans la pièce précédente ! − à la fois la jeune femme et le chœur, ce qui provoque un effet surprenant. Ce ne sera pas Oreste qui rachètera la génération : son jeu semble souligner la lâcheté que les critiques lui ont souvent attribuée, et dont témoignerait son recours à la ruse nocturne. En face, Clytemnestre et Égisthe gagnent donc en sympathie, voire en compassion, tant la fin expose l’horreur du double meurtre dont ils sont les victimes. À cet égard, W. Mouawad exploite le principe des dispositifs scéniques antiques de manière remarquable. La skénè, baraque rudimentaire qui permet de représenter un espace intérieur, opposé à l’extérieur de l’estrade et de l’orchestra, figure le palais d’Agamemnon. Clytemnestre passe sa tête par une ouverture qui y est pratiquée, de la taille d’une fenêtre, pour recevoir les coups qui provoqueront sa mort, figurée par un éclatement de blanc, avant qu’Oreste ne repousse violemment sa tête à l’intérieur. Un peu plus tard, cet usage de l’espace est inversé : Égisthe qui, chez Sophocle, demande à être tué au sein du palais, ce qui se produit dans la majorité des représentations que l’on voit, l’est ici au grand jour, hors de la skénè. Dans l’un et l’autre cas, les deux mises à mort sont d’une extrême violence. Ce recours aux dispositifs scéniques antiques est habilement exploité : ainsi l’eccyclème, la plate-forme roulante qui permet de présenter à la vue des spectateurs un autre espace, est ici utilisée pour faire chanter Bertrand Cantat, comme dans un commentaire extérieur de ce qui se passe.
La matinée se terminait sur l’Électre, dernière tragédie des femmes. Les partisans de la fille d’Agamemnon, et qui soutiendraient sa vengeance, sont ici exposés à souffrir : dès le début de la tragédie, c’est la démence qui caractérise Électre, une démence violente, qui marque la représentation au point de la rendre particulièrement éprouvante. C’est peut-être dans cette perspective aussi, et afin de donner l’image d’une dissociation, que W. Mouawad a choisi, dans la parodos, de faire interpréter par la même actrice − celle qui représentait la douce Ismène dans la pièce précédente ! − à la fois la jeune femme et le chœur, ce qui provoque un effet surprenant. Ce ne sera pas Oreste qui rachètera la génération : son jeu semble souligner la lâcheté que les critiques lui ont souvent attribuée, et dont témoignerait son recours à la ruse nocturne. En face, Clytemnestre et Égisthe gagnent donc en sympathie, voire en compassion, tant la fin expose l’horreur du double meurtre dont ils sont les victimes. À cet égard, W. Mouawad exploite le principe des dispositifs scéniques antiques de manière remarquable. La skénè, baraque rudimentaire qui permet de représenter un espace intérieur, opposé à l’extérieur de l’estrade et de l’orchestra, figure le palais d’Agamemnon. Clytemnestre passe sa tête par une ouverture qui y est pratiquée, de la taille d’une fenêtre, pour recevoir les coups qui provoqueront sa mort, figurée par un éclatement de blanc, avant qu’Oreste ne repousse violemment sa tête à l’intérieur. Un peu plus tard, cet usage de l’espace est inversé : Égisthe qui, chez Sophocle, demande à être tué au sein du palais, ce qui se produit dans la majorité des représentations que l’on voit, l’est ici au grand jour, hors de la skénè. Dans l’un et l’autre cas, les deux mises à mort sont d’une extrême violence. Ce recours aux dispositifs scéniques antiques est habilement exploité : ainsi l’eccyclème, la plate-forme roulante qui permet de présenter à la vue des spectateurs un autre espace, est ici utilisée pour faire chanter Bertrand Cantat, comme dans un commentaire extérieur de ce qui se passe.
Œdipe Roi

La quatrième pièce représentée, Œdipe Roi, était à la fois la première du cycle Des héros, et la dernière des tragédies sophocléennes traduites par Robert Davreu. Sa mise en scène, spectaculaire, illustre particulièrement bien la sensibilité de W. Mouawad à l’œuvre de Sophocle : « ce qui me frappe chez Sophocle, c’est son obsession à montrer comment le tragique s’abat sur celui qui, aveuglé par lui-même, ne voit pas sa démesure. Jusqu’à l’instant de la révélation du monstrueux […] il y a, en moi, un point aveugle, que je ne vois pas et que les autres voient davantage… Si je le voyais, que resterait-il de ma raison ? » Ce dévoilement se joue sur deux axes. Sur un plan horizontal, pendant la plus grande partie de la pièce, Œdipe est représenté au sein d’un carré, absolument immobile, les autres personnages entrant et sortant dans cette figure du carré. Œdipe ne les regarde pas, mais garde les yeux devant lui : ce caractère statique et les figures géométriques représentent sans doute à la fois la rigidité d’un héros trop confiant dans sa raison − jusqu’à la « passion de la connaissance » dont ont parlé les critiques − et la marche systématique du destin. Ce n’est que dans la dernière partie de la pièce, lorsque la vérité a éclaté, qu’Œdipe, désormais aveugle, dirige ses yeux vers ses interlocuteurs, entre en mouvement pour se tourner en tous sens et, finalement, se replier en position fœtale. C’est en effet également sur un axe vertical qu’évolue la représentation : avec la corde qui tombe d’en haut dès le début, que Jocaste transporte autour de son cou, préfigurant son suicide, et qu’elle enroule aux pieds d’Œdipe, rappelant ses origines ; avec les jeux de lumières, puisque les deux spots qui éclairent d’abord le visage d’Œdipe, lorsqu’il est encore roi et décideur pour son peuple, disparaissent, puis reviennent éclairer de la même façon, à la fin de la pièce, le visage de Créon ; avec l’écran de fond, qui baisse et se dévoile progressivement, en même temps que la vérité se fait jour.
Ajax, Philoctète et l’Œdipe à Colone
Quatre pièces traduites de Sophocle, donc, et quatre types de représentations différents, mais qui, chacun, témoignaient de riches partis pris. Le traitement des trois autres pièces est absolument dissemblable, et je ne fais ici que l’effleurer. Ajax, Philoctète et l’Œdipe à Colone font l’objet de trois réécritures par Wajdi Mouawad, respectivement Ajax-un cabaret, Inflammation du verbe vivre, et Les Larmes d’Œdipe. Si les héros des tragédies grecques en sont les personnages principaux, ou sont au moins évoqués, les trames, elles, sont principalement fondées sur les correspondances entre Grèce antique et mythique, et Grèce moderne, dont le destin précipité s’interroge et s’éclaire à la lumière du mythe. Le geste est donc différent : pourtant, là encore, Mouawad a besoin de puiser à ces thèmes sophocléens, dont il admire et fait admirer l’actualité.
Pour en savoir plus
- Les traductions sont disponibles chez Actes Sud. [↩]
Lire aussi sur Insula :
Anne de Cremoux, « Sophocle et Mouawad à Mons : les derniers jours du mois de juin », Insula [En ligne], ISSN 2427-8297, mis en ligne le 10 août 2015. URL : <https://insula.univ-lille.fr/2015/08/10/sophocle-et-mouawad-a-mons/>. Consulté le 1 February 2026.