Compte rendu de l’ouvrage de Sophie Schvalberg paru aux Presses universitaires de Rennes, 2014.
Entre la chute de l’Empire et la veille de la Première guerre mondiale, de nombreux documents et œuvres permettent d’appréhender la réception de l’archéologie grecque dans l’art français. Dans un ouvrage foisonnant paru aux Presses universitaires de Rennes, Sophie Schvalberg présente les divers approches et l’évolution du modèle grec par les peintres et les sculpteurs.
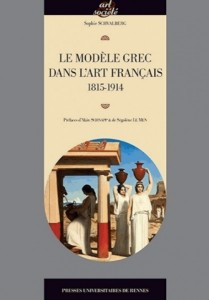
L’ouvrage de Sophie Schvalberg issu d’une thèse soutenue en 2008, entend analyser « la perception et la transformation du modèle grec par les artistes, en relation avec les débats du microcosme archéologique et les bouleversements institutionnels des Beaux-Arts ». Pour ce faire, l’auteure utilise un ensemble de sources qui donne la parole aux artistes eux-mêmes : journaux et mémoires d’artistes, y compris d’artistes mineurs, correspondances, écrits didactiques, textes de circonstance, etc. À ce recueil de sources, s’ajoute le dépouillement systématique des livrets du Salon des artistes français pour en extraire les sujets antiques, ainsi que les œuvres des lauréats du Grand Prix de Rome.
Au long des 370 pages de son ouvrage, Sophie Schvalberg démontre le va-et-vient entre art et archéologie et analyse l’évolution séculaire du modèle grec dans l’art français. Discipline naissante, l’archéologie sape peu à peu le modèle classique de l’Antiquité qui s’était construit dans les siècles précédents, en particulier à partir de la lecture de Winckelmann. De son côté, l’art valorise à sa manière les découvertes archéologiques et concours à la diffusion d’un savoir.
Belle mort et nus aguicheurs
De manière écrasante, et presque exclusive, les sujets du Concours de Rome sont tirés de la littérature grecque et latine. Dès lors, les travaux préparatoires à ce concours effectués au sein de l’École des Beaux-Arts de Paris ou dans les ateliers privés portent sur les mêmes thématiques.
Sophie Schvalberg distingue deux types de sujets antiques dans les sculptures et peintures : le registre épique, édifiant, et le registre sensuel et lyrique, les mêmes artistes pouvant user alternativement des deux registres. Si le Grand prix de Rome illustre souvent une « belle mort », un exemplum à valeur morale, si l’École des Beaux-Arts suit ce registre en demeurant le sanctuaire d’une Antiquité sérieuse, le Salon devient « au contraire l’exutoire d’une Antiquité galante ». Le recensement des livrets de Salon réalisé par Sophie Schvalberg est éclairant : le nombre d’œuvres représentant une Antiquité de convention y est très important, servant souvent « de simple prétexte à des nus aguicheurs ou des scènes de genre divertissantes ». Faunes, bacchantes et Vénus sont légion au Salon, au moins jusqu’au dernier tiers du XIXe siècle, quand une Grèce violente remplace une Grèce riante.
Quelle connaissance de l’art grec ont les artistes ?
L’auteure souligne que l’immense majorité des artistes n’a bénéficié que de l’école primaire. Rares sont ceux qui terminent le cycle du collège, où sont enseignés les langues anciennes et l’histoire antique. Pour avoir une connaissance de l’art grec, les artistes usent de divers canaux.
Le voyage … en Italie
Au début de XIXe siècle, l’art grec lui-même est essentiellement connu par Rome et l’Italie. Le voyage en Grèce − et donc la confrontation avec les antiquités grecques elles-mêmes − est alors une aventure périlleuse et rarissime. Quand ils seront rendus possibles, les voyages des artistes français en Grèce seront souvent sources d’une déception : Sophie Schvalberg relate la « sinistre rencontre avec le sol grec » de David d’Angers. À défaut d’aller en Grèce, donc, les pensionnaires de la Villa Médicis peuvent accéder aux collections et aux sites antiques d’Italie. Des excursions archéologiques sont organisées pour les artistes mais, sous le Second Empire, ces derniers délaissent les sites archéologiques, désintérêt qui affecte même les sites de Rome et de Pompéi.
Les collections muséales
Les artistes qui restent en France ont accès aux œuvres antiques grâce aux collections muséales, comme celles du Musée du Louvre. Certes, avec la défaite de Napoléon, le musée parisien perd de nombreux antiques amenés en France par l’empereur, mais les artistes peuvent étudier et copier les antiques en provenance de la collection Borghèse que vont bientôt rejoindre quelques antiques prestigieux : la « Vénus de Milo » (1820), l’« Apollon de Piombino » (1835), mais encore les vases de la collection Campana (milieu des années 1860), les statuettes de Tanagra (1877), la « Koré de Samos » (1881), la « Dame d’Auxerre » (1909), …
Les moulages, les mannequins et modèles vivants
Les artistes ont accès également aux nombreux moulages d’œuvres antiques. Au début du XIXe siècle, les musées européens s’échangent et installent au sein même de leurs collections de nombreux moulages à l’échelle. Les artistes parisiens vont au Louvre voir des statues originales et des copies, fréquentent les musées de copies de la capitale, comme le Musée des Études de l’École des Beaux-Arts1. Si les catalogues de moulages permettent l’acquisition de pièces archaïques à la fin du XIXe siècle, les œuvres copiées les plus diffusées resteront les sculptures classiques et hellénistiques tout au long de la période étudiée : les moulages les plus vendus seront essentiellement ceux du panthéon de Winckelmann. Si les musées et ateliers ont des collections de moulages, des collectionneurs privés et les artistes eux-mêmes font l’acquisition de moulages, voire d’antiques (comme Ingres ou Rodin). L’auteure relève que les modèles vivants prennent également souvent la pose d’œuvres antiques célèbres : tel modèle masculin prend la pose d’Hercule, tel enfant reprend la pose du « Tireur d’épine », quand ce ne sont pas des modèles en caoutchouc qui reproduisent les figures du « Discobole » ou de la « Vénus de Milo ».
Les livres et publications archéologiques
Les candidats au concours de Rome ont tout intérêt à fréquenter les bibliothèques pour s’instruire de l’histoire, des usages, des costumes des anciens. À Rome, avec l’enrichissement de sa bibliothèque, la Villa Médicis devient un centre d’études apprécié par les pensionnaires mais également fréquenté par des artistes qui ne le sont pas, comme Gustave Moreau. Les artistes lisent les auteurs anciens (Pline, Plutarque …), mais également les publications scientifiques et les rapports archéologiques dont la production ne cesse de s’accroître, devenant « exponentielle » sous le Second Empire. La Gazette des Beaux-Arts est fondée en 1859, La Gazette archéologique en 1875, le Bulletin de correspondance hellénique en 1877. Ingres, par exemple, suit avec intérêt les nouveautés scientifiques publiées dans les périodiques. Sophie Schvalberg croit ainsi retrouver des emprunts à ces recherches scientifiques dans les sculptures et les peintures, comme un emprunt au manuel Roret d’archéologie (1841-1842) dans une peinture d’Eugène Damery (1843), ou encore un détail d’une planche de l’Élite des monuments céramographiques de Lenormant et De Witte (1844) dans une statue d’Athéna par Pradier (1844-1846), …
Les citations d’œuvres antiques
Les artistes montrent leur connaissance de l’Antiquité en citant, voire paraphrasant, les œuvres antiques. Au début du XIXe siècle, les « Dioscures du Quirinal », popularisés en France par les moulages du Louvre, sont les antiques les plus « cités ». Jusqu’aux années 1820, les œuvres préférées de Winckelmann, en particulier l’« Apollon du Belvédère », sont souvent reprises par les artistes. Un changement s’opère à partir de 1815 avec l’entrée des marbres du Parthénon au British Museum.
La découverte des marbres du Parthénon

La découverte des marbres Elgin a un énorme retentissement dans le monde artistique, bousculant le panthéon établi par Winckelmann. Installés à Londres, les marbres arrachés au Parthénon permettent d’accéder à des sculptures provenant directement de Grèce, et non d’Italie, à des originaux grecs et non à des copies romaines. À défaut de pouvoir aller en Grèce, certains artistes font le déplacement en Angleterre pour admirer ces antiquités grecques, comme le sculpteur David d’Angers ; pour ceux qui ne font pas le déplacement à Londres, la découverte des marbres du Parthénon se fait grâce aux moulages rapidement effectués qui viennent enrichir les collections privées et celles des musées. Les sculptures du Parthénon inspirent les artistes qui vont en emprunter les figures tout au long du siècle2.
Au milieu du XIXe siècle, les marbres d’Elgin « sont devenus une rengaine pédagogique », inlassablement loués, constamment pris en exemple dans les ateliers et les manuels. Si les marbres du Parthénon sont régulièrement repris dans les œuvres modernes, d’autres antiques sont également cités, comme la « Vénus de Milo », véritable star française depuis son entrée au Louvre en 18213.
La découverte d’une Grèce antérieure à Phidias
L’art grec archaïque était souvent considéré comme une « enfance de l’art » et méprisé. Certes, en 1849 le Musée du Louvre crée une nouvelle salle appelée « le Musée grec primitif », mais il s’agissait, souligne Sophie Schvalberg, « de faire comprendre au public que le grand art grec, et notamment la sculpture de Phidias, est l’aboutissement de ces efforts progressifs ». Phidias restait le summum.
Des voix discordantes se font toutefois entendre dans le monde de l’archéologie. En 1862-1863, l’archéologue Ernest Beulé publie son Histoire de la sculpture avant Phidias, ouvrage dans lequel il dévalue les marbres du Parthénon au profit d’un art plus « géométrique » et d’une réhabilitation de l’art archaïque faisant jeu égal avec la statuaire classique. L’archéologue Olivier Rayet participe également à détruire certains préjugés à l’encontre de l’art archaïque grec (1878). Salomon Reinach vulgarise dans la Gazette des Beaux-Arts la découverte des Korés sur l’Acropole d’Athènes (1886). En 1909, Maxime Collignon décrit la Dame d’Auxerre sans avoir recours à un jugement de valeur esthétique. Cette reconsidération des antiquités avant Phidias se retrouve dans l’art. Avec le sculpteur Bourdelle, écrit Sophie Schvalberg, l’art archaïque « prend place désormais au sommet de la hiérarchie stylistique. Le trône de Phidias est renversé ».
Schliemann et Evans
La diffusion des recherches de Schliemann, à Troie, à Mycènes, a un impact extrêmement important à partir des années 1870. Rendant accessibles ses recherches à un public de non-spécialistes à travers d’importantes publications, Schliemann dote les œuvres d’art grec archaïque d’une signification forte qui obtiennent dès lors « une reconnaissance qu’elles n’avaient jamais eue auparavant ». Les artistes s’emparent des illustrations présentes dans les sommes produites par l’archéologue. Les fouilles d’Evans relayées par la presse font connaître la civilisation minoéenne à un grand public et influenceront les arts décoratifs en France et en Angleterre.
Des œuvres saturées d’indices archéologiques
Les artistes insèrent des éléments antiques comme autant de citations qui viennent en quelque sorte cautionner leurs œuvres comme autant de « pièces à conviction », pour reprendre la belle expression utilisée par Colombe Couëlle4. L’iconographie antique est recyclée, en particulier celle des peintures de céramique. Les vases antiques constituent le jardin secret d’Ingres, artiste qui a une grande culture archéologique5. David d’Angers partage ce même intérêt pour leur iconographie. Le sculpteur Simart utilise également le répertoire des vases grecs pour composer ses œuvres. Dans son analyse de « Fontaine antique » (1839) et « Femmes à la fontaine » (1841) de Dominique Papety, Sophie Schvalberg montre bien le jeu de citations de l’artiste qui transpose en particulier dans sa toile une Cariatide de l’Érechteion, probablement copiée d’un moulage.
Ces indices archéologiques, parfois multipliés à l’envi, font parfois sourire écrit Sophie Schvalberg, qui prend pour exemple la toile intitulée « Thésée reconnu par son père », qui valut à Hippolyte Flandrin d’obtenir le grand prix de Rome en 1832. Dans cette peinture, on trouve rassemblés un personnage inspiré d’un protagoniste de la frise du Parthénon, ainsi qu’un échantillonnage de vases « étrusques ». Enfin, l’artiste a juché à l’arrière plan, au sommet de l’Acropole, une grande effigie dorée d´Athéna. À propos de ce détail, Sophie Schvalberg souligne que « Flandrin veut prouver au jury sa connaissance des œuvres chryséléphantines de Phidias ; mais en la plaçant sur le toit du temple, il démontre à la fois son ignorance des cultes antiques et ses erreurs d’appréciation technique. » En l’occurrence, et contrairement à ce qu’écrit l’auteure, il ne semble pas que ce soit une maladresse de l’artiste : c’est moins l’Athéna chryséléphantine qui est ici représentée que l’Athéna Promachos, autre œuvre de Phidias, laquelle était en bronze doré et dominait l’acropole au point d’être visible depuis la mer. L’artiste a tiré cette œuvre d’une connaissance livresque : la statue de Phidias est en particulier mentionnée par Pausanias au premier livre de sa Périégèse.
Emprunts ou pillages ?
Les œuvres grecques sont recopiées et réinterprétées sans cesse au cours du siècle. Les peintres cherchent à faire « vrai », allant vers plus de réalisme, les artistes se nourrissant de connaissances archéologiques et des retraductions de la littérature classique. Cela ne va pas sans critique : le père de Gustave Moreau souhaite qu’un peintre ne soumette pas sa composition à une archéologie minutieuse ; Eugène Guillaume dénonce les « représentation[s] trop complaisante[s] des costumes [et des] accessoires » ; Victor-Mottez, quant à lui, énumère les emprunts antiques réalisés par Ingres et traite le peintre d’« éminemment pillard quoique original au premier degré. »

Cela étant, on découvre dans l’ouvrage de Sophie Schvalberg que les artistes n’ont pas seulement su profiter des découvertes archéologiques : ils ont également contribué à diffuser les trouvailles archéologiques. Ainsi, le peintre Papety expose au Salon de 1847 deux grandes aquarelles, dont la fameuse stèle d’Aristion intitulée « Bas-relief peint trouvé à Marathon » que l’artiste est le premier à montrer intégralement, et en couleur. Quant à Charles Simart, il tente une reconstitution de l’Athéna chryséléphantine du Parthénon décriée par l’archéologue Beulé dans La Revue des deux mondes, mais saluée par un autre savant, François Lenormant : « la statue exposée en 1855 est de beaucoup la restitution la meilleure qui ait été proposée pour l’Athéné Parthénos de Phidias ».
Un art grec banalisé, ironisé, renouvelé
Ce goût pour l’antique influence les arts décoratifs, en particulier dans les motifs de tapisserie. Tout au long du siècle, le modèle grec est banalisé dans la production de bibelots en bronze (ou en plomb) reproduisant des statues antiques. L’Antiquité gagne également l’industrie du luxe : la marque « Dissey et Piver » popularise l’image de Psyché et l’Amour sur ses étiquettes de flacons de parfum (vers 1830).

Le peintre Gérôme adopte un parti-pris délibérément satirique, sous couvert d’Antiquité, se servant de l’archéologie de manière à la fois experte et désinvolte. Il apporte une humeur plaisante avec des sujets qui deviennent vite populaires : sa « Phryné devant l’aréopage » (1861), qui génère beaucoup de scandale, est reproduite en couleur par le médium photographique par la maison Goupil.
La reproduction mécanique des œuvres ou sujets antiques, la production massivement « à l’antique » du Salon de Paris, provoquent un désintérêt, de la moquerie, voire un rejet, pour l’antiquité grecque par les artistes en quête de nouveautés. Dans ce contexte, les caricatures d’Honoré Daumier raillent les œuvres présentées au Salon et les exercices de l’École des Beaux-Arts.
L’absence de Huysmans
Si Sophie Schvalberg donne massivement la parole aux artistes eux-mêmes, les écrivains sont également cités dans sa démonstration (Baudelaire, …). Dans ce contexte, on ne peut qu’être surpris de l’absence de Joris-Karl Huysmans qui a été un critique d’art durant plusieurs décennies (ses écrits sur l’art couvrent les années 1867-1905) et dont le propos entre en résonance avec la thèse de Sophie Schvalberg6.
Visiteur du Salon, des expositions et envois pour le grand Prix de Rome, Huysmans fustige les faiseurs d’« antiquailles » et les « déplorables rengaines » des sujets tirés de l’histoire sainte ou de l’histoire ancienne.
À propos de l’exposition pour le grand Prix de Rome de 1876 − dont le sujet était « Priam demanda à Achille le corps d’Hector … » − Huysmans évoque « cette vaste banalité qui s’accommode si bien, en poésie comme en peinture, des sujets grecs. »
En visite au Salon de 1881, Huysmans reste songeur face au tableau de Lawrence Alma-Tadéma, « En route pour le temple de Cérès » :
« Par quelle bizarre faculté, par quel phénomène psychique, M. Tadéma peut-il s’abstraire ainsi de son époque, et vous représenter, comme s’il les avait eus sous les yeux, des sujets antiques ? »
On sait par l’ouvrage de Sophie Schvalberg qu’Alma-Tadema constitue divers albums de photographies d’antiquités pour se documenter.
La question qui revient dans les écrits sur l’art de Huysmans est : pourquoi toujours faire de l’antique ?
« Dites-leur (aux artistes du Salon) que le moderne fournirait tout aussi bien que l’antique le sujet d’une grande œuvre, ils restent stupéfiés et ils s’indignent ». (Le Salon de 1879)
Au Salon de 1885, Huysmans constate que les sujets ne varient pas :
« Comme toujours, il y a une aimable cohue de collégiens récitant leur leçon d’Homère et préparant en sourdine leur petit thème … »
Le critique avait déjà avoué son ennui après sa visite au Salon officiel de 1882 :
« Qui a vu l’une a vu l’autre ; les expositions officielles se suivent et se ressemblent ».
Un autre modèle grec

Si le modèle antique est remis en cause, il sera également régénéré par le courant symboliste. Avec Puvis de Chavannes, l’Antiquité devient atemporelle, voire « an-archéologique ». Gustave Moreau réinterprète l’Antiquité dans un symbolisme complexe, donnant une forme inédite aux mythes. Pour la sculpture, Sophie Schvalberg montre les emplois emblématiques des formes archaïques dans les œuvres d’Antoine Bourdelle, d’Aristide Maillol et de Joseph Bernard et comment ces artistes donnent une vigueur nouvelle au matériau antique.
Les archives d’Antoine Bourdelle témoignent de l’intérêt du sculpteur pour le domaine de l’archéologie, mais il n’en est pas tributaire. Le sculpteur réinvente : son célèbre « Héraklès archer » est ainsi une « fabrication métissée » résultant du croisement d’une tête de Kouros et d’un profil aztèque, dans une position qui est l’adaptation tonique d’un archer du fronton d’Égine. Avec Bourdelle et Maillol, l’archaïsme a perdu son sourire. Quant à Rodin, dont la préférence va à la sculpture classique dans un idéal de représentation du corps humain, il trouve dans les fragments des sculptures antiques une justification de ses propres œuvres, « fragmentaires par décision esthétique, hors de toute action du temps ».
En conclusion
On ne peut rendre compte ici de l’ensemble des informations données par un livre foisonnant qui nous donne une vision hétéroclite de la Grèce7. On soulignera l’intérêt que nous avons eu à découvrir des documents exhumés et des artistes parfois méconnus. Le modèle grec de l’art français n’est pas seulement utile pour comprendre et mieux lire les peintures et les sculptures du XIXe siècle. Les visions que les artistes donnèrent de la Grèce jusqu’en 1914 ont en effet imprégné les esprits bien plus longtemps encore, dans les manuels scolaires, dans les arts décoratifs, la bande-dessinée ou le cinéma.
Formellement, le texte − issu d’une thèse − est agréable à lire, même si le découpage à la fois chronologique et thématique contraint l’auteure à de nombreuses redites, et à d’étonnants découpages. Saluons l’abondance d’illustrations, avec plus de 150 représentations (un cahier en couleur reproduit des illustrations déjà présentées en noir et blanc dans le texte). Le corpus est riche et varié : reproductions d’antiques, de tableaux, de sculptures, d’extraits de journaux, de livres, de catalogues de vente, d’échantillons de papiers peints, d’étiquettes de parfum, etc. Certains rapprochements sont particulièrement éclairants : la proximité du tableau « Priam aux pieds d’Achille » de Martin Langlois (ill. 14) et d’un sarcophage de la collection Borghèse du Louvre traitant du même sujet (ill. 15) vaut mieux qu’un long discours. On regrettera que la quantité d’illustrations a parfois été préférée à la qualité : « Stratonice ou La maladie d’Antiochus » d’Ingres (ill. 28), tableau si important, eût sans doute mérité mieux que d’être réduit à la taille d’un timbre poste. On ne distingue rien non plus du bas relief du temple d’Assos du musée du Louvre (ill. 70) et on ne peut qu’être d’accord avec Maillol qui s’exclamait, à propos des frontons d’Olympie : « les photos ne vous en donnent aucune idée. Moi j’ai tout de même vu ça ». Il nous reste à revoir ces œuvres des Prix de Rome oubliés et des Salons décriés avec le livre de Sophie Schvalberg pour guide.
À propos de ce livre
Sophie Schvalberg, Le modèle grec dans l’art français 1815-1914, préfaces d’Alain Schnapp et de Ségolène Le Men, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014, 371 p., XII p. de planches en couleur, ISBN 978-2-7535-2751-5
- Voir sur le site de l’éditeur : http://www.pur-editions.fr
Crédits photographiques
Les illustrations sont reprises de Wikipedia : « Le pardon de Bonchamps » de David d’Angers, dans l’abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil, photographie de Touriste : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BonchampsParDavidDAngers.jpg ; « Minerve » par Simart et Duponchel – Bouilhet 1910 : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minerve_par_Simart_et_Duponchel_-_Bouilhet_1910_-_Internet_Archive_%28adjusted%29.jpg ; « Phrynè devant l’Aréopage » (détail) de Jean-Léon Gérôme : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me,_Phryne_revealed_before_the_Areopagus_%281861,_detail%29.jpg ; « Héraklès archer » d’Antoine Bourdelle – National Museum of Western Art, Tokyo : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%A9rakl%C3%A8s_archer_%28Antoine_Bourdelle%29_-_National_Museum_of_Western_Art,_Tokyo_-_DSC08033.JPG
- On pourra regretter que l’auteure centre son travail uniquement sur les institutions parisiennes (École des Beaux-Arts de Paris, Musée du Louvre, Sorbonne, Salon des artistes français, …). Ainsi, traite t-elle des collections parisiennes de moulages et oublie la province. En 1913, Louis Liard note pourtant dans La Revue de Paris que, « beaucoup mieux que l’Université de Paris sont pourvues certaines universités des départements, Bordeaux, Nancy, Lyon, Montpellier et Lille ». Cf. Louis Liard, « Les Bienfaiteurs de l’Université de Paris », La Revue de Paris, 1913, T.20, p. 345. Rappelons que les universités françaises ont en effet constitué au XIXe siècle des collections de moulages, parfois importantes, qui − si elles étaient utiles aux étudiants − pouvaient être ouvertes à un public plus large et servir de modèles aux artistes. Ce fut le cas, en particulier, à la Faculté des lettres de Lille qui, au début du XXe siècle, passa un accord avec l’École des Beaux-Arts de la ville pour que les élèves puissent venir à l’Université dessiner et modeler à partir des moulages et photographies constituant l’Institut d’histoire de l’art. Cf. François Benoit, « L’enseignement de l’histoire de l’art et l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Lille », Revue internationale de l’enseignement, 41, 1901, p. 538. Ces gypsothèques universitaires participèrent également à diffuser en France une Antiquité modèle, comme l’a récemment rappelé Soline Morinière, « Les gypsothèques universitaires, diffusion d’une Antiquité modèle », Anabases, 18, 2013, 71-84, et inspirer des artistes « des départements ». [↩]
- Le jeune David d’Angers utilise l’Ilyssos du Parthénon pour représenter le général Bonchamps graciant les prisonniers républicains (1822). Ramey donne une version pudique de cette même figure de l’Ilyssos pour son saint Marc réalisé pour le fronton de l’église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye (1825-1827), tandis que son voisin Saint-Luc croise la position du Mars Ludovici de Rome et du Thésée du Parthénon. Le sculpteur Simart réinterprète la figure d’Ilyssos pour créer la figure d’Oreste réfugié à l’autel de Pallas (1838). La frise des cavaliers du Parthénon est peinte dans un improbable intérieur grec antique par François Chifflart, prix de Rome en 1851 pour sa toile « Périclès au lit de mort de son fils ». Trois cavaliers, échappés de cette même frise, chevauchent en arrière plan de la toile de Papety, « Femmes grecques à la fontaine » (1839-1840). Le groupe des Parques (aujourd’hui identifié comme Aphrodite et Dioné) est introduit dans une toile d’Ingres en 1856, « La naissance de la dernière Muse ». Etc. [↩]
- On la retrouve dès 1824 dans une « Psyché » sculptée par Pradier. On la surprend encore dans la figure centrale du tableau peint par Puvis de Chavannes en 1879 : « Jeunes filles au bord de la mer » [↩]
- Colombe Couëlle, « Désirs d’Antique ou comment rêver le passé gréco-romain dans la peinture européenne de la seconde moitié du xixe siècle », Anabases, 11 | 2010, 21-54. [↩]
- Voir à ce sujet le catalogue de l’exposition Ingres & l’Antique. [↩]
- Voir Joris-Karl Huysmans, Écrits sur l’art : 1867-1905, édition établie, présentée et annotée par Patrice Locmant, Bartillat, 2006. [↩]
- Le livre est en particulier régulièrement ponctué du feuilleton sur la polychromie. [↩]
Lire aussi sur Insula :
Christophe Hugot, « Le modèle grec de l’art français : 1815-1914 », Insula [En ligne], ISSN 2427-8297, mis en ligne le 6 octobre 2014. URL : <https://insula.univ-lille.fr/2014/10/06/le-modele-grec-art-francais-1815-1914/>. Consulté le 12 July 2025.
Pingback : Le modèle grec de l’art fran&ccedi...
Pingback : Le modèle grec de l’art fran&ccedi...
Pingback : Ovide et les métamorphoses de l’art moderne | Insula